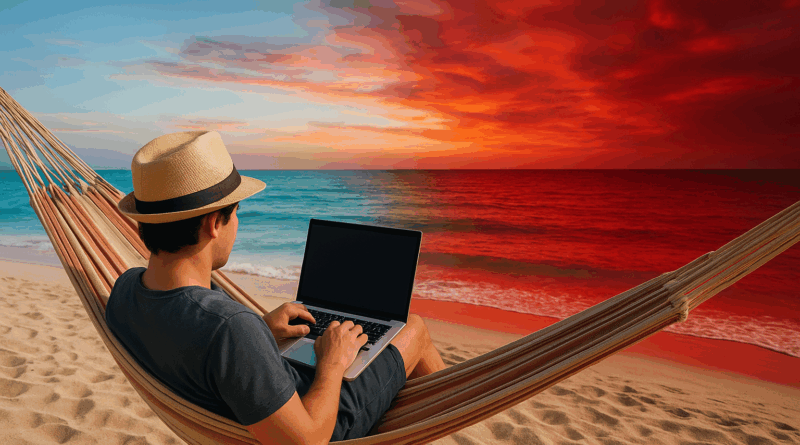L’illusion technologique
“La technique moderne a permis de diminuer considérablement la somme de travail requise pour procurer à chacun les choses indispensables à la vie…
Si le salarié ordinaire travaillait quatre heures par jour, il y aurait assez de tout pour tout le monde, et pas de chômage…
La morale du travail est une morale d’esclave, et le monde moderne n’a nul besoin de l’esclavage.”
Bertrand Russell, Éloge de l’oisiveté, 1932
On nous promet depuis un siècle que les gains de productivité devraient libérer les humains du travail. Pourtant, le temps de travail stagne, voire augmente pour certains. L’IA risque de suivre le même scénario.
Pourquoi travaillons-nous toujours autant ?
- Le “piège du travailisme” (le travail comme valeur morale)
Nous restons culturellement prisonniers de l’éthique protestante. La valeur d’une personne est indexée sur son emploi ; travailler moins reste associé à la paresse ou au manque d’ambition. Le plein-emploi demeure un dogme politique, et “avoir un travail” reste socialement plus valorisé que “mener une vie libre et créative”. C’est le prolongement direct de la logique décrite par Max Weber : le travail n’est plus un moyen, mais une fin morale. - L’effet de redistribution des gains
Les gains de productivité ne sont pas redistribués sous forme de temps libre, mais captés :- Plus de profits pour les détenteurs du capital, aujourd’hui aussi les propriétaires des IA et des données.
- Plus de consommation, avec la création continue de nouveaux besoins et désirs ; on travaille pour acheter ce que la publicité nous pousse à vouloir.
- Plus d’inégalités, car seule une minorité profite du temps libéré tandis que la majorité travaille autant pour compenser la hausse du coût de la vie (logement, santé, éducation). En somme, les gains servent à nourrir la croissance, pas à libérer le temps humain.
- La création de “travaux factices” (Bullshit Jobs)
Comme l’a montré David Graeber, la technologie a automatisé beaucoup de tâches réellement productives, mais elle a fait exploser les emplois de gestion, de contrôle et de communication interne. Ces fonctions, souvent perçues comme inutiles par ceux qui les occupent, existent surtout pour maintenir le système de l’emploi à plein temps et éviter la remise en cause du “travail pour le travail”. - Le problème politique de la répartition
Russell avait raison sur le potentiel — quatre heures par jour suffiraient largement — mais il sous-estimait la difficulté politique. Réduire le temps de travail supposerait une redistribution radicale des richesses et une redéfinition du pouvoir. Qui déciderait de la répartition ? Qui accepterait une stagnation du PIB ? Tant que la croissance reste l’objectif central, réduire le travail collectif est vu comme une menace, non comme une libération.
Et l’IA ?
L’intelligence artificielle suit la même trajectoire que les précédentes révolutions industrielles. Son potentiel de libération est immense, mais son intégration dans un système capitaliste non régulé conduit très probablement à :
- Une augmentation des inégalités (ceux qui possèdent les IA s’enrichissent massivement).
- Une polarisation du marché du travail (quelques emplois très qualifiés, beaucoup d’emplois précaires ou fragmentés).
- Une pression à “occuper” les gens : plutôt que partager le travail utile, on crée de nouvelles activités vides de sens.
Le problème n’est pas technique, mais culturel et politique.
La technologie, qu’elle soit mécanique, numérique ou “intelligente”, n’émancipe pas d’elle-même : elle renforce les valeurs du système qui la porte. Tant que ce système valorisera la production plutôt que la création, et le rendement plutôt que le sens, chaque progrès ne fera qu’intensifier le travail.
Tant que nous ne changerons pas ce que le travail représente, nous ne changerons pas le temps qu’il occupe.